Hausse du seuil de pauvreté extrême: Un nouvel étalon aux implications multiples pour les États
Economie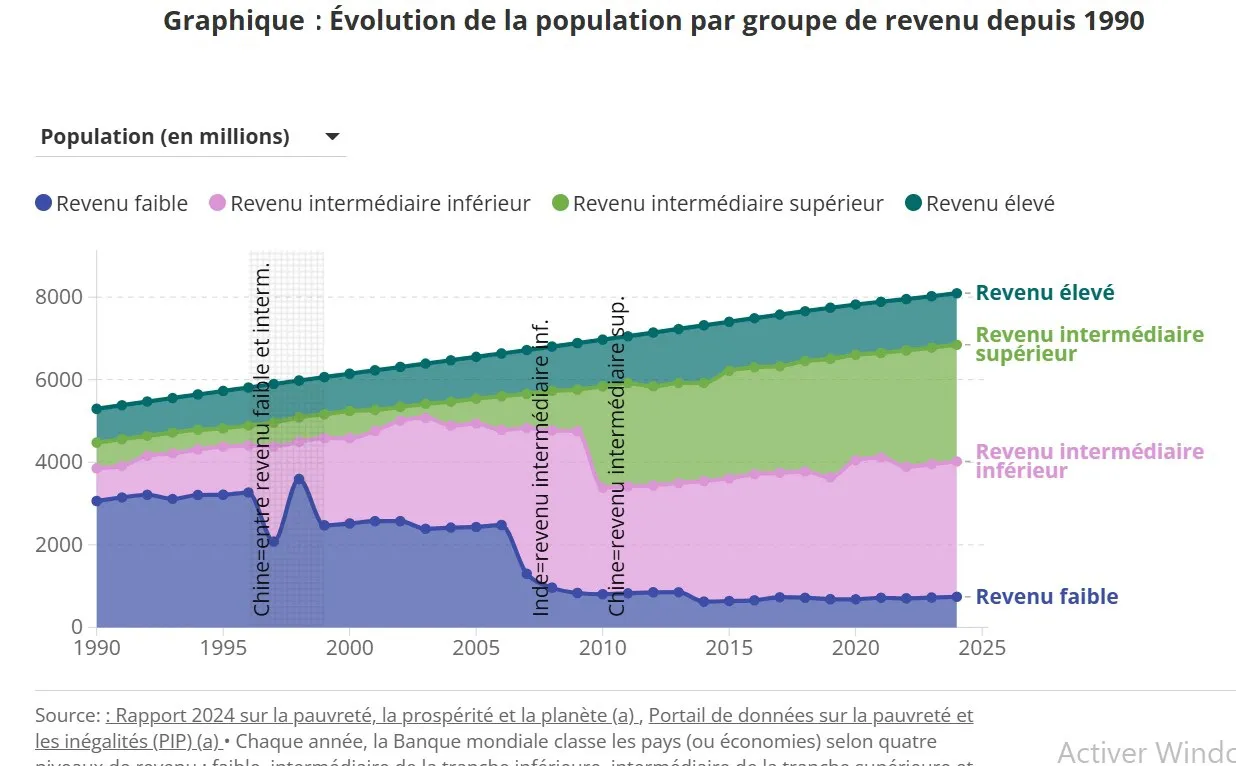 Banque mondiale
Banque mondiale
La
Banque mondiale a relevé le seuil de référence de l’extrême pauvreté jusque-là
fixé à 2,15 dollars, pour l’aligner sur les nouvelles données de parité de
Pouvoir d’achat (Ppa) collectées en 2021. Ce changement, loin d’être anodin,
redéfinit les contours de la pauvreté extrême dans le monde et appelle à une
adaptation des politiques publiques au niveau des États.
Par Arnaud DOUMANHOUN, le 10 juin 2025 à 08h21 Durée 3 min.
La
Banque mondiale calcule les seuils de pauvreté afin de suivre les progrès
mondiaux vers l’éradication de l’extrême pauvreté. Le nouveau seuil de 3
dollars par jour, équivalent à environ 2000 francs Cfa, élargit automatiquement
le périmètre des populations classées en situation d’extrême précarité. Des
millions de personnes qui, selon l’ancien barème, n’étaient pas comptabilisées
parmi les plus pauvres, le seront désormais. Cette révision statistique,
d’apparence technique, soulève des implications concrètes pour les États. Le
relèvement du seuil international de pauvreté signifie, en premier lieu, que
l'ancien niveau ne reflétait plus le coût réel de la vie dans les pays à faible
revenu. Dans un contexte de hausse continue des prix et d’inflation
généralisée, ce que l’on pouvait acheter il y a dix ou quinze ans avec 500
francs Cfa est aujourd’hui largement hors de portée. La Banque mondiale a ainsi
reconnu que ses précédentes estimations ne suffisaient plus à mesurer les
besoins fondamentaux des populations vulnérables. C’est dire qu’il ne s’agit
pas simplement d’un chiffre revu à la hausse. C’est la reconnaissance
institutionnelle que le « minimum vital » coûte plus cher, même dans les pays
les plus pauvres. En conséquence, les indicateurs de pauvreté utilisés pour
établir des classements et guider les interventions internationales devront
être recalculés. Certains États jusqu’ici considérés comme en développement
pourraient désormais être reclassés parmi les pays en situation de pauvreté
extrême.
Une pression sur les politiques salariales et sociales
En
fixant un nouveau seuil, la Banque mondiale envoie également un signal fort aux
gouvernants. Il leur faudra ajuster les politiques économiques, notamment les
politiques salariales. Les États sont désormais confrontés à l’obligation de
repenser leurs mécanismes de redistribution de la richesse. Dans de nombreux
pays à faible revenu, les salaires minimums (Smig) restent en dessous de ce
seuil de 3 dollars par jour (environ 2000 F Cfa). L’actualisation du seuil
appelle donc à une révision à la hausse des rémunérations de base pour les
fonctionnaires, les agents publics et les travailleurs du secteur privé. Sans
quoi, la précarité continuera de gagner du terrain, malgré les discours sur la
croissance économique. De plus, la richesse nationale produite ne suffit pas :
encore faut-il qu’elle soit équitablement redistribuée. Cette mise à jour
relance donc le débat sur la fiscalité, les subventions sociales, les
programmes de soutien aux ménages vulnérables et l’investissement dans les
services sociaux de base comme la santé et l’éducation.
Au
Bénin, le Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) a été revalorisé
depuis janvier 2023. Il est passé de 40 000 F Cfa à 52 000 F Cfa, soit une
augmentation de 30 %, après consultation des partenaires sociaux. Et les filets
sociaux se sont renforcés ces dernières années. Il est donc à observer que même
si des efforts restent à faire pour combler le gap, le taux appliqué en ce qui
concerne le Smig au Bénin, se rapproche des nouvelles directives de la Banque
mondiale, avec ce relèvement du seuil de référence à l’extrême pauvreté.
Globalement, c’est une évidence que les politiques de développement ne pourront
plus se satisfaire d’une croissance économique quantitative. L’attention se
porte davantage sur la qualité de vie, mesurée en termes d’accès à des services
essentiels, de sécurité alimentaire, de logement décent, ou encore de pouvoir
d’achat. Le calcul de la pauvreté ne se limite plus au revenu monétaire. Il
intègre une approche multidimensionnelle. Santé, éducation, logement, accès à
l’eau potable, connectivité numérique… tous ces facteurs entrent désormais dans
le radar de la Banque mondiale pour déterminer les niveaux de pauvreté. Cette
approche holistique oblige les États à adopter des plans de développement
intégrés et à cibler plus finement leurs interventions sociales.
Certains pays pourraient voir leur situation se dégrader statistiquement, passant d’un statut de pays en développement à celui de pays en extrême pauvreté, s’ils n’ont pas entre-temps adapté leurs politiques. À l’inverse, d’autres qui ont déjà investi dans des réformes structurelles, augmenté les salaires de base ou développé des filets sociaux efficaces, pourraient amortir l’effet de cette reclassification. Le Bénin pourrait se retrouver dans cette dernière catégorie. Quoi qu’il en soit, cette décision de la Banque mondiale repose sur une logique de réalisme : elle aligne les chiffres sur la vie réelle des populations. Elle rappelle aussi que les Objectifs de développement durable, en particulier celui d’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, sont encore loin d’être atteints. La mise à jour des seuils ne représente donc pas seulement un changement méthodologique, mais bien un appel à l’action. Dans un monde où les inégalités persistent, où les crises, climatiques, économiques, sanitaires, se multiplient, la réévaluation du seuil de pauvreté constitue un baromètre utile, voire vital, pour orienter les efforts des États et de la communauté internationale.
Articles Similaires
-
Rapport Business Ready 2025: Le Bénin s’impose comme l’une des économies les plus performantes
30 janv. 2026 03:38:08
-
Relations économiques Bénin - Brésil: Un mémorandum d'accord pour des partenariats multisectoriels
30 janv. 2026 07:26:11
-
5e édition de l'afterwork Pme Connect: Plus de 250 jeunes entrepreneurs mobilisés
30 janv. 2026 07:23:10
-
Investissements directs étrangers en 2025: Recul de 2 % des flux vers les économies en développement
29 janv. 2026 07:17:29
-
Economie mondiale: Entre résilience et perspectives mitigées
29 janv. 2026 07:13:58
-
Dette publique: Entre recours au marché régional et maîtrise des risques
28 janv. 2026 08:54:04
- Voir plus


