Tribune: Les erreurs cognitives et les politiques aux conséquences tragiques
Messages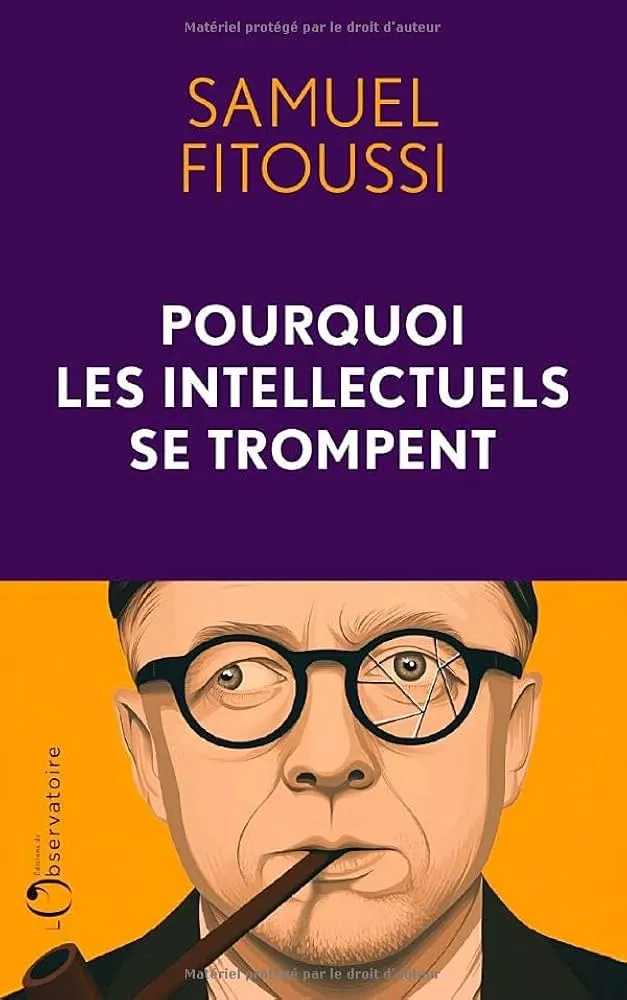
La
réflexion autour du livre de Samuel Fitoussi, "Pourquoi les intellectuels
se trompent", met en lumière les mécanismes par lesquels ces esprits
brillants, censés éclairer le jugement collectif, se sont laissé piéger par des
illusions idéologiques, des biais cognitifs ou des intérêts personnels. Invite
à revisiter les rôles ambigus des intellectuels dans les choix décisifs de
l’histoire.
Par Théodore C. Loko, le 02 juin 2025 à 07h46 Durée 3 min.
L’histoire de l’humanité est jalonnée de décisions politiques désastreuses, souvent soutenues, inspirées ou justifiées par des intellectuels de renom. Le livre de Samuel Fitoussi, "Pourquoi les intellectuels se trompent", met en lumière les mécanismes par lesquels ces esprits brillants, censés éclairer le jugement collectif, se sont laissé piéger par des illusions idéologiques, des biais cognitifs ou des intérêts personnels. Cette réflexion engage à revisiter les rôles ambigus que les intellectuels ont joués dans les choix décisifs de l’histoire, tout en interrogeant leur responsabilité face aux tragédies humaines qui en ont découlé.
Mais comment ces esprits supposément éclairés en sont-ils venus à servir l’obscurité des régimes autoritaires ?
Dès le XXe siècle, les grandes idéologies ont offert un terrain propice à ces dérives. Des penseurs de renom ont ainsi soutenu, avec ferveur, des régimes totalitaires au nom du progrès ou de la justice sociale. Le cas emblématique de Jean-Paul Sartre, qui minimisa les crimes de Staline tout en prônant un marxisme révolutionnaire, illustre cette tendance à sacrifier la complexité du réel sur l’autel d’un idéal dogmatique. L’intellectuel devient alors prisonnier de ses propres schémas mentaux, et préfère ignorer les faits qui les contredisent, ce que Fitoussi identifie comme une forme de dissonance cognitive renforcée par le désir d’appartenance à une communauté idéologique.
Cette cécité volontaire ne se limite pas aux grandes idéologies : elle touche aussi les méthodes d’analyse elles-mêmes.
À
cette dissonance s’ajoute le biais de confirmation, qui pousse certains
intellectuels à rechercher uniquement les données qui confortent leur vision du
monde. Le tragique soutien d’une partie de l’intelligentsia occidentale aux
révolutions maoïstes, malgré les famines de masse et la répression, démontre
combien l’aveuglement idéologique peut se doubler d’un mépris latent pour les
victimes dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans le récit attendu.
Fitoussi
insiste sur la nécessité de ne pas confondre brillance intellectuelle et
lucidité morale : penser juste n’est pas toujours penser bien.
Il devient alors essentiel de poser une autre question fondamentale : les idées peuvent-elles survivre à l’épreuve du réel ?
Un
autre facteur d’erreur est le mépris affiché par certains intellectuels pour
l’empirie, la donnée concrète, la réalité du terrain. Leur raisonnement peut
être parfaitement logique en théorie, mais tragiquement déconnecté des
contraintes humaines, culturelles et sociales.
Ainsi, les projets technocratiques d’ingénierie sociale, défendus avec ardeur dans les années 1950-1970 par des économistes et philosophes influents, ont souvent produit des effets pervers: déstabilisation de sociétés traditionnelles, destruction de solidarités locales, autoritarisme planificateur. L’intellectuel qui ne se soumet pas à l’épreuve du réel devient un idéologue, non un guide éclairé.
La situation devient encore plus préoccupante lorsque les intellectuels cessent d’être des critiques pour devenir des courtisans.
Dans
le contexte africain, ces dérives prennent une forme particulièrement
préoccupante.
Nombre
d’intellectuels, au lieu de jouer un rôle critique vis-à-vis des pouvoirs en
place, se sont enfermés dans une logique de compromission. Guidés par des
intérêts personnels, ils ont troqué leur indépendance d’esprit contre des
postes, des privilèges ou une reconnaissance symbolique. Ce phénomène, déjà
dénoncé par Julien Benda sous le nom de «trahison des clercs », prend ici une
acuité dramatique. Plutôt que de porter la voix des sans-voix, certains
préfèrent servir les régimes autoritaires, en habillant leur soumission de
discours panafricanistes ou anticoloniaux.
Ce comportement alimente le clientélisme, étouffe le débat démocratique et prive les sociétés africaines d’une conscience critique authentique.
Alors, quel nouveau modèle pour penser et agir ?
Face
à ces constats, une exigence éthique et intellectuelle nouvelle s’impose. Pour
éviter les tragédies du passé, l’intellectuel du XXIe siècle devra conjuguer
raison critique, rigueur empirique et responsabilité morale. La raison critique
suppose un effort de décentrement : interroger les dogmes, même ceux issus de
sa propre culture ou de ses convictions politiques, et refuser les
simplifications idéologiques. La rigueur empirique exige de confronter toute
idée aux faits, de fonder l’analyse sur des données, des expériences
vérifiables, de dialoguer avec les sciences et les réalités concrètes. Quant à
la responsabilité morale, elle engage à penser aux conséquences humaines des
idées que l’on diffuse : aucune théorie ne vaut de sacrifier des vies, aucune
utopie ne justifie le silence face à la souffrance.
Mais au-delà des principes, il s’agit de réinventer une attitude : celle d’un intellectuel à hauteur d’homme.
Cette
triple exigence pourrait être complétée par une posture nouvelle :
l’intellectuel dialogique. Il ne s’agit plus de penser sur le monde depuis une
position d’autorité, mais de penser avec le monde, dans une écoute active des
savoirs locaux, des vécus pluriels et des contradictions du réel.
L’intellectuel véritable, aujourd’hui, est celui qui accepte de douter, de
dialoguer, de corriger sa pensée à l’épreuve des faits et des autres. Il ne
fuit pas la complexité: il l’habite, avec lucidité et courage.
Ainsi se dessine le portrait exigeant, mais nécessaire, d’un intellectuel renouvelé, à la fois critique, modeste, ancré et responsable. Une figure dont nos sociétés, fragilisées par les crises écologiques, géopolitiques et morales, ont plus que jamais besoin.
C’est à cette condition que l’intellectuel pourra accomplir l’une de ses missions les plus fondamentales : contribuer à la formation de la souveraineté sociale.
La volonté générale, dont parlait Rousseau, n’est pas une abstraction philosophique détachée du peuple ; elle se construit dans les échanges, dans les confrontations d’idées, dans l’émergence d’une conscience partagée du bien commun. L’intellectuel ne doit pas fuir ce processus : il doit en être l’un des artisans lucides, pédagogues et engagés. En articulant les savoirs à la réalité sociale, il participe à la maturation de cette souveraineté collective qui fonde la démocratie véritable.
Mais à quoi bon penser juste si l’on perd de vue l’essentiel?
Dans
un monde où les idées circulent plus vite que jamais, où l’influence
intellectuelle peut construire ou détruire des nations, il devient impératif de
rappeler la valeur ultime de l’engagement intellectuel : servir la vérité, la
justice et la dignité humaine.
La
séduction du pouvoir, la vanité académique ou le confort idéologique ne doivent
jamais faire oublier que chaque idée défendue engage des vies, des destinées,
des peuples.
À
ce titre, l’avertissement du Christ résonne comme une sentence pour toute
conscience égarée : « Et que sert-il à l’homme de gagner le monde, s’il perd
son âme ? » (Marc 8, 36).
L’intellectuel du XXIe siècle ne pourra être une lumière pour les autres qu’à condition de ne pas trahir la sienne.
Ambassadeur
(à la retraite) Théodore C. LOKO Enseignant-chercheur Président de “Capital
social chrétien”
Articles Similaires
-
Conseil de la paix (ONU-BIS): La paix comme un produit marchand au cœur d’un chaos hobbésien
26 janv. 2026 12:42:34
-
Accord Ue– Mercosur: Des stratégies intégrées pour une version moderne de la diplomatie économique
23 janv. 2026 10:32:13
-
De l’adaptation à l’épanouissement: WAPCO Bénin accompagne le développement progressif des étudiants béninois en Chine
22 janv. 2026 10:32:30
-
Tribune: Les leçons de l'intervention américaine du 03 janvier 2026 à Caracas
13 janv. 2026 11:31:33
-
CAF Trophy Hunt: Gagnez un Samsung Galaxy Z Fold7, une Xbox Series X, un iPad Air et d'autres prix avec la promotion lxBet !
08 janv. 2026 06:21:58
-
10ᵉ législature: Moele-Bénin, un engagement clair pour la sécurité et la défense nationale
07 janv. 2026 07:47:05
- Voir plus


